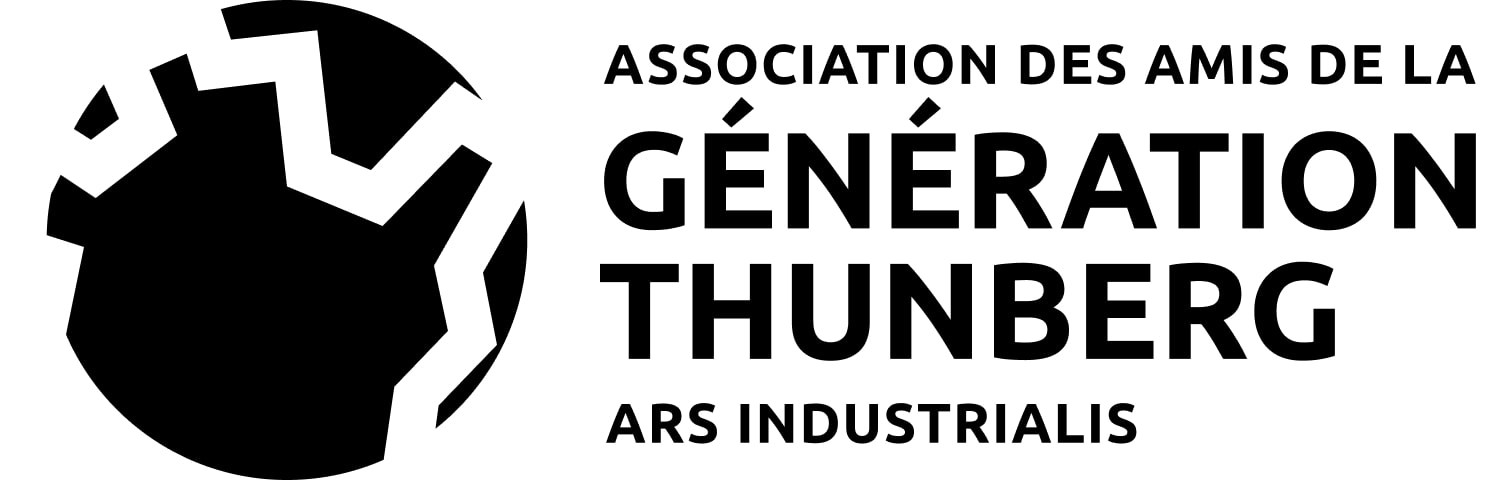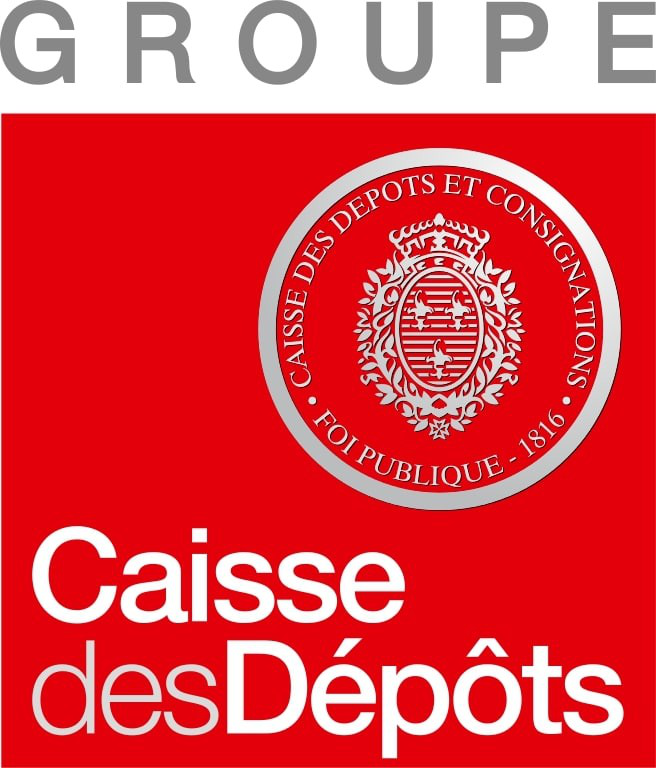Entretiens du Nouveau Monde Industriel Préparatoires 2024
Publié : Actualités, Events |
Séminaire préparatoire : 25 et 26 juin 2024
Maison Suger, FMSH, 16 rue Suger, 75006 Paris
Partenaires :
ECOLOGIE ET ORGANOLOGIE DE L’INDUSTRIE
Pour une bifurcation vers l’éco-technologie et les nouvelles localités industrielles
1 – Thème des entretiens
Le 12 mai 2023 en visite à Dunkerque, ville du Nord érigée par l’Élysée en symbole de sa politique de réindustrialisation tournée vers la transition écologique, Emmanuel Macron a confirmé l’implantation d’une usine de batteries du taïwanais Prologium (3000 emplois, investissement de 5,2 milliards d’euros) ainsi que la construction prochaine d’une usine de batteries électriques au lithium (1700 emplois, investissement de 1,5 milliard d’euros) fruit d’un partenariat entre le français Orano et la société chinoise XTC. Selon le vice-président de ProLogium1, ces projets de « gigafactorys » constituent un « véritable écosystème pour les batteries dans le nord de la France ».
A quelle « écologie » cet « écosystème » fait-il référence ? S’il procède bien d’une « planification écologique » s’appuie-t-il sur des dynamiques territoriales durables ou répond-il d’abord à un contexte géopolitique national et international ? Ne faut-il pas renoncer à la notion d’écosystème quand celle-ci n’a plus aucun des caractères anti-entropiques et historiques que l’on trouve dans le vivant ?
Dans le cadre de nos entretiens, pour mieux comprendre les enjeux et les tensions et proposer de nouvelles approches industrielles, nous partons de la richesse et de la diversité des « localités » qui produisent de nouveaux savoirs. Est-ce que les fablabs, les usines distribuées, les circuits courts, l’économie circulaire, les projets low-tech et les coopératives numériques peuvent contribuer à une dynamique d’innovation ascendante qui crée une « nouvelle écologie industrielle » ?
Écologie et industrie. Au premier abord, les deux termes semblent antinomiques tant l’actualité politique dresse de plus en plus les défenseurs de l’environnement contre les tenants d’un capitalisme vert ou d’un techno-solutionnisme éclairé comme seul remède possible à la crise. Loin de tout retour à une ère post-industrielle, ne faut-il pas repenser à la suite de Bernard Stiegler une ère hyper-industrielle comme porte de sortie au modèle productiviste de la même manière que la Convention et le Saint-Simonisme posaient l’industrie comme une nouvelle révolution ?
La question de l’industrie était déjà à l’origine de la création de l’association Ars Industrialis en 2005 qui proposait de partir de cette définition pour la critiquer et la dépasser : « L’industrie est ce qui suppose du capital libre s’investissant dans de la technologie permettant de gagner en productivité et de réaliser des économies d’échelles ». Comment aujourd’hui repenser cette question de la productivité et donc de la production dans ce que beaucoup évoquent comme une nécessaire « transition » ? Or, même le discours sur la « transition », se révèle être, à tout le moins sur le plan énergétique, au mieux une injonction consensuelle car non définie, ou au pire une contre-vérité scientifique et historique comme le soutient aujourd’hui Jean-Baptiste Fressoz2.
Plus que celle de la transition, notre hypothèse est celle de la « bifurcation »3 à la suite de Gilbert Simondon et Bernard Stiegler. Elle tient d’une part qu’il n’y a pas d’écologie possible sans organologie et sans pharmacologie et que, d’autre part, repenser l’écosystème de l’industrie c’est d’abord penser la technologie comme un écosystème. Ne faut-il pas ici tisser des relations d’échelle et des analogies entre l’industrie et la technologie telle que théorisée par Simondon ? Une « éco-technologie » pour reprendre le terme jamais employé par Simondon mais tel qu’il est discuté dans l’ouvrage collectif dirigé Jean-Hugues Barthelemy et Ludovic Duhem4 ou plus récemment par Victor Petit dans l’ouvrage coordonné par Mathieu Triclot5 mais qui était déjà discuté dans les colloques de Cerisy organisés par Vincent Bontems en 2016 et en 20236.
Cette question de l’éco-technologie est à l’opposé d’une vision « verte » de l’industrie qui se réduit le plus souvent à diminuer l’impact énergétique, ou l’impact carbone. C’est une vision systémique qui reconsidère des localités de production où la question du « rendement » ou du « progrès » s’envisage à la suite de Simondon d’abord comme une « concrétisation » c’est-à-dire une optimisation métastable du couplage des individus (biologiques, techniques, sociaux) à leurs milieux. N’est-ce pas une autre manière de s’interroger sur la mécroissance ? N’est-ce pas aussi une adresse aux designers pour concevoir des dispositifs capables d’intégrer les contraintes des grandes échelles dans un fonctionnement local ? Une dynamique visant à développer une nouvelle forme de « bienveillance dispositive » qui croise, à bien des égards, ce que l’on nomme aujourd’hui le mouvement « low-tech » et une forme d’extension industrielle des Fablabs ?
Cette nouvelle écologie industrielle serait en réalité imprégnée d’un « milieu » numérique qu’il n’est plus légitime d’isoler comme une filière indépendante. Pourtant, ce milieu apparaît plus que jamais à la fois comme le poison et le remède. Un pharmakon qui, par son impact énergétique (le numérique représente 10% de la consommation énergétique avec un doublement tous les 4 ans), à la fois révèle (apokálupsis) et masque l’ampleur d’une crise qui n’est pas qu’énergétique et environnementale puisqu’elle affecte aussi nos pratiques sociales et intellectuelles. En effet, le déploiement massif des systèmes de traitement de grandes masses de données, dits « d’intelligence artificielle » affecte à présent profondément le monde du travail et de l’industrie mais aussi la production de savoir et la vie de l’esprit. De même que nos systèmes biologiques sont bouleversés par une réduction dramatique de la biodiversité, l’hégémonie des plateformes numériques planétaires et leur utilisation massive de l’IA pour produire du code provoque une perte de technodiversité dans les environnements de développement et favorise aussi, par la maximisation du probable, une menace pour la noodiversité. Nous sommes inexorablement entrainés dans une nouvelle course à la croissance du recours au calcul qui produit une civilisation non pas trop technicienne mais mal-technicienne selon l’expression du philosophe Gilbert Simondon7. Comment, dès lors, repenser une industrie non seulement éco-responsable et sobre, voir ouverte à des renoncements positifs8 mais aussi plus ouverte à de nouvelles formes de savoirs, savoir-faire et savoir-vivre ? Quelles analogies et perspectives croisées pouvons-nous tisser entre le soin de la Terre et le soin de nos écosystèmes industriels ? C’était déjà l’enjeu de nos derniers Entretiens du Nouveau Monde Industriel en 2022 sur le thème « Organisation du vivant, organologie des savoirs » et en 2023 sur « Jeux, gestes et savoirs ». Il s’agit aussi cette année de croiser à nouveaux frais cette question des écosystèmes industriels avec l’enjeu déterminant de la fabrique de la ville, objet de nos Entretiens en 20189.
Penseur des territoires apprenants, Pierre Veltz tient que cette nouvelle industrie façonne et est à la fois modelée par le territoire. Elle oblige à repenser à nouveau frais la localité, loin de tout localisme national ou de vision uniforme de la « relocalisation ». De multiples dispositifs et labels nationaux entendent y contribuer : Territoires d’industrie, Territoires d’innovation, Contrats de relance et de transition, Cœur de ville, Petites villes de demain, …10 L’approche nécessite bien une vision, non seulement technocratique, mais aussi politique dans un contexte où les frontières traditionnelles de la « production » se brouillent, hors du clivage production (artificiel)/engendrement (naturel), et où la production ne s’oppose plus à la « consommation ». Cette approche relancerait peut-être la nécessité d’une articulation sobre et durable, d’une intermittence garantie à tous, entre outil et milieu, entre l’usine et la ville, entre autonomie et hétéronomie, entre travail et emploi. Intermittence au cœur de la proposition de l’économie contributive expérimentée par l’IRI en Seine-Saint-Denis à travers le programme Territoire Apprenant Contributif et la monnaie locale ECO11.
2 – Contexte des entretiens préparatoires
Comme chaque année pour préparer les Entretiens du Nouveau Monde Industriel, l’IRI organise un séminaire favorisant le dialogue et les échanges avec des contributeurs de diverses disciplines et de différents domaines industriels. En croisant pensée théorique et expériences de terrain – y compris celle conduite par l’IRI en Seine-Saint-Denis – il s’agit cette année de tenter de penser les conditions d’une bifurcation vers le design de nouveaux milieux industriels. Cette nouvelle « écologie de l’industrie » – à la fois méthode et système – est ici pensée comme une organologie au sens de Bernard Stiegler en ce qu’elle articule à nouveau frais les écosystèmes biologiques, technologiques et socio-économiques. Elle s’appuie sur la pensée simondonienne d’une éco-technologie pour reconfigurer de nouvelles localités industrielles en prise directe avec les bouleversements géopolitiques et cosmotechniques contemporains. Au redéploiement industriel des années 80/90 permis par la planétarisation des techniques numériques des réseaux (technosphère) et au mythe de l’industrie sans usines, a succédé une géopolitique de l’anthropocène qui impose de repenser l’articulation entre l’industrie et la société et entre production et (re)génération, la place des travailleurs et des habitants, le rôle de la science et la question de la redistribution de la valeur.
Le séminaire préparatoire est programmé les 25 et 26 juin en partenariat avec la FMSH (Maison Suger) et les Entretiens des 18 et 19 décembre au Centre Pompidou concluront cette année de travaux en favorisant au maximum la présentation de méthodes d’expérimentation concrètes notamment de la part des pouvoirs publics, de l’ESS et des acteurs de la nouvelle industrie décentralisée comme des grands groupes.
3 – Programme
25 juin
10H-12H30
Session 1 – Transition ou bifurcation ? Regards croisés sur l’histoire et les politiques industrielles
Transition ou bifurcation ? Écosystèmes ou milieux ? Planification centralisée ou innovation ascendante ? Modèles physiques ou modèles biologiques ? Quels regards pouvons-nous porter sur l’histoire de l’industrie et des politiques industrielles et sur leurs fondements épistémologiques et sémiotiques pour dégager une nouvelle critique et une nouvelle fabrique de l’industrie ?
Intervenants
- Giuseppe Longo, mathématicien (ENS-Cnrs) – Le nouveau pythagorisme impératif, convergences épistémiques entre technosciences et industrie
- Sophie Pène, sociolinguiste (Un. Paris Cité) – Ce qu’écosystème veut dire, dans la langue du « réarmement de l’économie »
- Michal Krzykawski, philosophe (Silesia Un. et programme NEST) – Les fonds socioculturels de l’intelligence artificielle. Quels épistémologies pratiques et savoir-faire pour les grands modèles de langage européens ?
- Pierre Musso, philosophe (professeur honoraire à Telecom ParisTech) – La vision occidentale de l’industrie construite à coups de bifurcations
14H-16H30
Session 2 – Eco-technologie, techno-esthétique et imaginaires de l’industrie
Pour Gilbert Simondon, l’individu (et par extension l’objet technique) qui optimise le « rendement » de son rapport à son milieu fonde une « techno-esthétique » à tel point que nous devrions pouvoir distinguer, dans le monde industriel, les systèmes monstrueux ou infidèles à leur milieu, des systèmes optimisés dans leur concrétisation, c’est-à-dire aussi proches des systèmes biologiques. Comment cette approche que l’on peut qualifier d’« éco-technologique » peut-elle modifier nos démarches d’ingénierie et de design mais aussi les pratiques esthétiques elles-mêmes ? Comment les communautés alternatives et notamment dans le champ de l’écologie peuvent ainsi se réapproprier un discours sur l’industrie ?
Intervenants
- Victor Petit, philosophe (UTT) – Eco-technologie. Pour une conception orientée milieux.
- Laurence Allard, maîtresse de conférences, Sciences de la Communication, Université Lille-Fasest-Etudes Culturelles/IRCAV-Sorbonne Nouvelle – Eco-technologies décoloniales : faire avec les diggers de l’anthropocène
- Alexandre Monnin, philosophe (ESC Clermont) – Politiser le renoncement
- Pierre-Antoine Chardel, philosophe (IMT-BS) et Olaf Avenati, designer (ESAD Reims)
17H-19H
Session 3 – Fabriquer, jouer pour se désautomatiser, vers une nouvelle écologie du travail
Dès son plus jeune âge, l’enfant est confronté à des jouets renforçant les stéréotypes avec lesquels il doit jouer et dont il doit se jouer. Le jouet est ainsi le lieu d’une automatisation à dépasser pour bifurquer. N’est-ce pas aussi l’enjeu de l’ergonomie que de mieux comprendre et maitriser les processus de production pour les dépasser dans le cadre d’une nouvelle écologie du travail durable ? Comment cette nouvelle conception du travail se forge depuis le plus jeune âge et comment peut-elle ouvrir à des perspectives de désautomatisation et de déprolétarisation dans l’entreprise ?
Intervenants
- Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre (IRI), Le jouet et sa récupération par l’industrie numérique – Effets délétères sur l’enfance et sur l’adolescence en l’absence d’une protection par le milieu.
- Nadia Heddad, ergonome (Un. Paris 1)
- Sébastien Crozier, Président de la CFE-CGC Orange
Intervention conclusive de la journée :
- Mael Montévil, mathématique et biologie (Cnrs/ENS), Qu’appelle-t-on produire ?
26 juin
10H-12H30
Session 4 – Écologie et économie de l’industrie : investissement et croissance
Même si les deux notions gagnent à être distinguées, industrie et économie vont de pair. Cette session s’interroge sur les nouvelles écologies/organologies des territoires et leur impact sur les dynamiques économiques durables. Elle tente aussi d’éclairer comment une écologie de l’industrie implique une nouvelle écologie de la monnaie.
Intervenants
- Franck Cormerais (IRI-Université Bordeaux Montaigne) – Ecologie et économie de la contribution, vers une solidarité organologique industrieuse
- Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste (Un. Paris 1 & Institut Veblen) – Transformer la monnaie pour rendre possible la bifurcation sociale-écologique
- Laurent Monnet (Maire Adjoint de Saint-Denis, Conseiller Territorial Plaine Commune), industrie et économie urbaine (sous réserve) et Théo Sentis (IRI), coordinateur du projet de monnaie locale ECO, Industrie et économie urbaine (sous réserve)
14H-16H
Session 5 – Nouvelles Localités industrielles et usines distribuées
Il s’agira dans cette session de donner à voir des exemples concrets de ces nouvelles localités industrielles parfois anciennes ou parfois totalement reconfigurées par le nouveau milieu technologique ou numérique. Quelles leçons peuvent se dégager de ces singularités ?
Intervenants
- Olivier Landau (IRI) – L’usine distribuée
- Véronique Maire (ESAD de Reims) – Design, industrie et territoire – Intégration des designers pour tester la mise en réseau des acteurs de la filière bois autour d’outils numériques et de productions ciblées en circuit court avec une démarche d’éco-conception ?
- Caroline Granier (La fabrique de l’industrie)
16H30-19H
Session 6 – Ecologie du numérique : Fablabs, low-tech, open-source, coopératives de données
Comment le numérique, souvent pointé du doigt pour son impact environnemental à l’heure du fort développement des IAG, peut-il dessiner de nouveaux écosystèmes à même de mieux se réapproprier son « contexte » local et global ? Comment les communautés du libre, « l’éthique du hacker », la figure de l’amateur et du bricoleur, peuvent reconstituer des espaces de capacitation, d’autonomie, d’invention et d’industrie ?
Intervenants
- Frédéric Lemarchand, sociologue et Fréderic Villain (Demand Side Instruments)
- Noel Fitzpatrick, philosophe (TU Dublin et programme NEST)
- Paul Benoit et Rémi Bouzel (Qarnot Computing), La révolution du cloud computing et ses enjeux thermodynamiques et environnementaux.
- Tahar Belaid (8 connect)
4 – Résumés
Laurence Allard (Université Lille-Fasest-Etudes Culturelles/IRCAV-Sorbonne Nouvelle), Eco-technologies décoloniales : faire avec les diggers de l’anthropocène
La notion « d’éco-technolologies » sera déployée en contexte numérique pour prendre en considération des conditions matérialo-infrastructurelles d’existence des textualités générées par les applications mobiles ou services digitaux en suivant l’approche de la physiciennne queer Karend Barad du « material turn ». Le programme d’une saisie éco-technologique décoloniale du numérique impactant matériellement les milieux à tous les stades de son industrie se focalisera sur les tonnes de déchets alimentant les « mines urbaines » de l’anthropocène. Ce sont plus particulièrement aux « mines urbaines domestiques » et aux acteurs mobilisés autour de ces « communs négatifs » (Alexandre Monnin) que sont les réparateurs associatifs, les designers ou artistes concernés, les militants écologistes décoloniaux dans différents contextes (repair café, fablabs) que sera consacrée cette communication. En hommage aux premiers « bêcheux » luttant contre les enclosures et pionniers du mouvement des communs en s’opposant aux enclosures du 17ème siècle ainsi qu’aux artistes de la culture libre du San Francisco des années 1966, nous appellerons « diggers de l’anthropocène » celles et ceux qui reconfigurent avec ingéniosité et développent un imaginaire du numérique du « faire avec et du déjà là » et agissent pour le mouvement naissant de l’urban digging.
Paul Benoit et Rémi Bouzel (Qarnot Computing), La révolution du cloud computing et ses enjeux thermodynamiques et environnementaux.
Qarnot est un fournisseur de services cloud avec une approche innovante qui valorise la chaleur fatale informatique pour alimenter des réseaux de chaleur, des piscines et des industries. Les services cloud tiennent aujourd’hui un rôle central dans notre économie. Ces services s’appuient sur le déploiement massif de datacenters, déploiement qui est comparable à celui des usines du XXème siècle sur lesquelles s’appuie toujours la production des biens de consommation. Les puissances de calcul atteintes sont sans précédent et les enjeux thermodynamiques que nous rencontrons dans le champ énergétique sont inédits. Cette présentation sera l’occasion de revenir sur ces enjeux, de rappeler les pratiques traditionnelles de réduction de l’empreinte environnementale des datacenters et les nouvelles voies portées par la recherche académique et des entreprises comme Qarnot.
Pierre-Antoine Chardel (IMT-BS) et Olaf Avenati (ESAD de Reims), Désalignement, design et nouvelles formes de la matérialité
Nous vivons actuellement un désalignement (Latour), une dissonance entre la société d’abondance d’objets et de services, relais des récits fatigués portés par la société de consommation, d’une part ; et d’autre part une nouvelle réalité, un nouveau monde, dont l’enjeu est la préservation de l’habitabilité de notre « spaceship earth » (Buckminster Fuller). Si nous semblons encore collectivement hésiter sur les chemins que nous voulons emprunter pour préserver cette habitabilité, nous voyons bien la nécessité d’établir un autre rapport au monde matériel. Mais nous peinons à élaborer et à diffuser des visions de cet avenir. Par ailleurs, les technologies numériques, particulièrement dans leurs derniers développements (outils accélérateurs/normalisateurs de la production et de l’interaction, déplacement du travail vers les IA génératives, adossement aux semi-finis de tiers) posent le récit d’un pouvoir d’agir dématérialisé, sans limites d’usage, radicalement transformateur et libérateur, et accessible à tous comme une commodité. Au plan de l’expérience esthétique, l’intégration discrète de ces technologies dans le quotidien, leur intuitivité, leur apparente quasi-gratuité sont perçus comme des qualités. Alors même que ces technologies nécessitent en réalité beaucoup d’efforts de conception et d’énergie pour obtenir cette apparente légèreté. A partir de là, il nous semble intéressant, utile, et même nécessaire, de tenter, par le design, de donner forme à un nouveau rapport à la matérialité, nourri à la fois par les connaissances scientifiques et empiriques, en posant l’hypothèse qu’un travail sur les formes peut proposer de nouvelles représentations et porter des récits régénérés. Intéressant, car ces explorations nous aident à mieux percevoir la complexité des faits dans le monde matériel qui nous entoure. Utile, car ces représentations qui dé-spécialisent, qui désenclavent les connaissances, peuvent servir de plateforme à une conversation plus ouverte à l’ensemble des parties prenantes. Nécessaire, peut-être, en ce qu’elle pourraient constituer, par accumulation du déjà-là, les grains encore épars d’une force de basculement des représentations pour déplacer l’imaginaire sociétal et aider à l’aligner avec la matérialité du monde vivant.
Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste (Un. Paris 1 & Institut Veblen) – Transformer la monnaie pour rendre possible la bifurcation sociale-écologique
On ne changera pas la société en changeant seulement la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie : tout grand changement sociétal va de pair avec un changement monétaire. La bifurcation écologique et sociale devra donc s’appuyer sur une bifurcation monétaire, adaptant la monnaie aux défis de notre temps pour mobiliser sa puissance de transformation. Les formes institutionnelles de la monnaie ne sont pas gravées dans le marbre, comme le révèle son histoire longue, des premières monnaies-coquillages aux cryptomonnaies récentes. Elles se réinventent à chaque époque en cohérence avec les bouleversements économiques, politiques ou culturels qui transforment la société.
Dans le pouvoir de la monnaie (Editions Les liens qui libèrent, janvier 2024), Jézabel Couppey-Soubeyran et ses co-auteurs défendent la mise en place d’un mode de complémentaire de création de monnaie centrale affectée au financement de la part non rentable des investissements indispensables à la bifurcation sociale-écologique de nos sociétés. Cette proposition s’inscrit dans une approche de la monnaie qui croise économie institutionnaliste, histoire anthropologique, et philosophie.
Ressource : https://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Le_pouvoir_de_la_monnaie-9791020924261-1-1-0-1.html
Giuseppe Longo, mathématicien (ENS-Cnrs) – Le nouveau pythagorisme impératif, convergences épistémiques entre technosciences et industrie
Le codage numérique de lettres de l’alphabet, une pratique certes très ancienne, est devenue une technique rigoureuse et générale grâce aux mathématiques des années 1930. L’encodage de l’univers dans des suites discrètes (bien séparées) de nombres et de lettres s’en est suivi, au cours et après la IIème guerre mondiale – justement qualifiée de « guerre du code ». Les suites finies de lettres et de nombres entiers deviennent alors un équivalent général du « tout est code » : les chromosomes sont assimilés à un « code-script » du développement avec Schrödinger en 1944 ; toute forme, dans n’importe quel nombre de dimensions, peut être aujourd’hui encodée sur un écran fait de pixels, à leurs tours encodés par des suites de 0 et de 1 dans la mémoire d’un ordinateur. Or, les langages de programmation, même ceux qui nous permettent de dessiner, d’enregistrer et de produire la parole… sont encodés dans des suites de 0-1, en passant par des compilateurs et des systèmes d’exploitation, qui décrivent des ordres pour modifier d’autres suites de 0-1. Et, sur l’écran d’un ordinateur, où rien ne bouge, une pomme (rouge) tombe car des ordres (un programme) imposent à des pixels de changer de couleur, blanc/rouge/blanc, des changements d’état. « Les lois de la physique sont des algorithmes », proclament de nombreux récipiendaires du Turing Awards (Leivant, Pearl) : elles suivent un déterminisme laplacien, enrichi par des interactions entre programmes. De même, l’ADN est une suite d’instructions (un programme), nous expliquent des Prix Nobel de biologie (de Monod à Doudna, 2020). Le monde fonctionne donc car il obéit à des ordres, en dépit du bruit qui peut, occasionnellement, en affecter le réglage cartésien (Monod), l’exactitude de l’« édition » (editing) de l’ADN (Doudna), la dynamique laplacienne (Pearl). Faire de la science contre ce pythagorisme impératif qui nous gouverne et qui s’est imposé dans l’industrie demande aux jeunes le courage de bifurquer vers des visions dialectiques et immanentes, qui promeuvent la diversité théorique et d’analyses causales, la production de nouveauté en collaboration, non-préprogrammées par le pouvoir économique, politique et industriel.
Ressource : https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Couv_Table-introLeCauchemarPromethee.pdf
Véronique Maire (ESAD de Reims) – Design, industrie et territoire
Comment intégrer des designers pour tester la mise en réseau des acteurs de la filière bois autour d’outils numériques et de productions ciblées en circuit court avec une démarche d’éco-conception ? Collaboration avec le CRITT Bois.
Ressource : https://chaire-idis.fr/projets/continuum-numerique-filiere-bois/
Alexandre Monnin, philosophe (ESC-Clermont) – Au-delà de l’anti-industrialisme et du business as usual, est-il possible de bien poser les questions techniques et industrielles aujourd’hui ?
La question technologique est au cœur des bouleversements en cours. Que l’on évoque l’Anthropocène, le Capitalocène ou encore le franchissement en cours des limites planétaires, dans tous les cas, la technologie occupe un rôle central et apparaît pour les uns comme la cause de nos maux, et pour d’autres, comme la solution à ces derniers. Elle est souvent convoquée sur le banc des accusés au titre d’une critique du techno-solutionnisme ou de l’extractivisme. Plusieurs publications récentes mettant en cause la transition énergétique de même que des chantiers industriels en cours (en particulier le projet de mine de lithium d’Échassières, dans l’Allier) ont accentué la critique de l’industrialisme et l’ont étendu à la transition écologique elle-même, contribuant à la décrédibiliser (d’une manière assez spécifique à la France, les questions de transition écologique et de justice climatique se mariant mieux dans d’autres pays), parfois en résonance avec les efforts de désinformation des lobbies climato-négationnistes. Un ré-ancrage territorial, axé sur les enjeux de subsistance, prendrait ainsi la place d’une modernité sur le point de chanceler. Pourtant, à rebours de ces velléités, tous les scénarios du GIEC nécessitent un certain niveau de développement et de transfert technologique pour sortir de l’ornière – en plus des changements importants en matière de politique, de gouvernance, de lutte contre les inégalités, etc. D’autres scénarios, décroissants ou assimilés, mobilisent également les gains d’efficacité à venir et la décarbonation pour imaginer des modes de vie viables à 8 milliards d’individus. Quelle place, dès lors, un point de vue informé et un tant soit peu radical (au sens étymologique du terme) doit-il accorder à la technologie et à l’industrie ? La voie du rejet ou la bascule vers les low-tech est-elle la seule possible ? Faut-il sortir de la production, comme nous y invitent, à différents titres, Bruno Latour, Baptiste Morizot, Dusan Kazic ou Emilie Hache ? Est-ce envisageable sans sombrer dans une forme de gnosticisme ? Dans le cas contraire, existe-t-il aujourd’hui une possibilité de faire place à la technologie et à l’industrie de manière non-naïve, en intégrant la question du renoncement, et sans laisser de côté les questions difficiles pour l’écologie de la puissance et de la géopolitique, plus vives que jamais.
Ressource : https://www.editionsdivergences.com/livre/politiser-le-renoncement
Maël Montévil (ENS-Cnrs) – Qu’appelle-t-on produire ?
Les notions de production et d’industrie ont, contre leurs origines historiques, été confinées dans les deux dernier siècles à ce que l’on appelle le secteur secondaire, le secteur primaire étant, lui, dévolu à la matière dite première et qui regroupe pelle-mêle l’exploitation du vivant sauvage et domestique ainsi que l’extraction minière. Pourtant les fourmis sont bien – plus ou moins – industrieuses, le concept de reproduction est l’un des plus fondamental en biologie et même les processus physiques irréversibles produisent de l’entropie. Alors que le champs et les acteurs de l’industrie se reconfigurent tant pour des raisons technologiques « qu’écologiques », il nous semble pertinent de repenser ce que signifie produire à l’aune tant de la physique que de la biologie et de la technologie.
Sophie Pène, sociolinguiste (Un. Paris Cité) – Ce qu’écosystème veut dire, dans la langue du « réarmement de l’économie »
Lors de ses vœux 2024, Emmanuel Macron a souhaité marquer les esprits avec la métaphore d’un « réarmement » s’appliquant entre autres à l’économie, aux services publics, à « la relance de nos industries vertes ». « Réarmement » qualifiea posterioriune politique industrielle dont la langue sera sommairement décrite ici au travers de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Compétences et Métiers d’Avenir (CMA, France 2030), de ses différents discours d’accompagnement et de projets lauréats. L’hypothèse discutée concerne le façonnement d’un fac-similé d’écosystèmes, qui aurait entre autres marques la volonté de promouvoir une « langue » (au sens de V Klemperer, lu par J Chapoutot, « qui s’insinue dans le langage courant et s’inscrit de manière inconsciente au plus intime de chacun »). Que dit cette langue décrivant un écosystème industriel circonstanciel et artificiel : 1- du récit public politique et administratif sur l’industrie comme élément d’écosystèmes sociaux et vivants, 2- de la prise en compte ou non de la relation des jeunes à l’industrie (puisque le programme CMA vise des « compétences » pour l’industrie future), 3- des contraintes adaptatives que les entités candidates admettent pour parler cette langue et devenir éligibles aux financements, 4- de la prise en compte ou non du cadre actuel réel, scientifique, philosophique, moral, écologique, au sein duquel s’inscrira historiquement la volonté gouvernementale. En conclusion, et en vue de la discussion, s’ensuit-il une conception de l’industrie qu’une analyse organologique pourrait accompagner dans une reconception régénérative et restaurative ?
Victor Petit, philosophe (UTT) – Eco-technologie. Pour une conception orientée milieux.
Il s’agira d’expliciter ce qui distingue l’éco-technologie de l’ingénierie environnementale, et pour ce faire de mettre en avant ce que nous avons appelé dans un manuel collectif récent la « conception orientée milieux ». Nous montrerons en quel sens une certaine philosophie du Milieu-Tech est susceptible de subvertir les oppositions classiques, d’ouvrir la technologie sur son milieu, de substituer le soin à la maîtrise et de développer une techno-diversité.
Ressource :
Notes :
1 Cité dans l’article du Monde et de l’AFP publié le 12 mai 2023
2 Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil, 2024
3 Bernard Stiegler, Bifurquer, il n’y a pas d’alternative », Collectif, éd. de poche, Les Liens qui libèrent, Paris, 2022
4 JH Barthélémy et L. Duhem (Dir.), Ecologie et technologie. Redéfinir le progrès après Simondon. Ed. Matériologiques, 2022
5 Victor Petit, « L’écologie de Bernard Stiegler. », 30 juin 2021, Cahiers Costech, numéro 4 ; V. Petit, C. Collomb. « Chapitre 2. Situer l’écologie technologique de Simondon ? », in Jean-Hugues Barthélémy éd., ibid., pp. 63-82 ; Victor Petit, « Chapitre. 3, Technologie du milieu vs. Ingénierie de l’environnement », in Mathieu Triclot, Prendre soin des milieux. Manuel de conception technologique, éd. Matériologiques
6 Où sont les technologies d’avenir ? Colloque organisé sous la direction de Vincent Bontems (INSTN-CEA), Christian Fauré (Octo Technology) et Roland Lehoucq (CEA Saclay), 30/08-5/09/2023
7 Gilbert Simondon, Sur la technique, PUF, p. 411.
8 Alexandre Monnin, Politiser le renoncement, Divergences, 2023
9 Bernard Stiegler (Dir.), Le nouveau génie urbain, Fyp, 2019
10 Caroline Granier, Refaire de l’industrie un projet de territoire, préface de Pierre Veltz, Presses des Mines, 2023, p. 7
11 https://lecoleduterrain.fr/maniere-de-faire/leconomie-contributive/

 in english
in english en français
en français