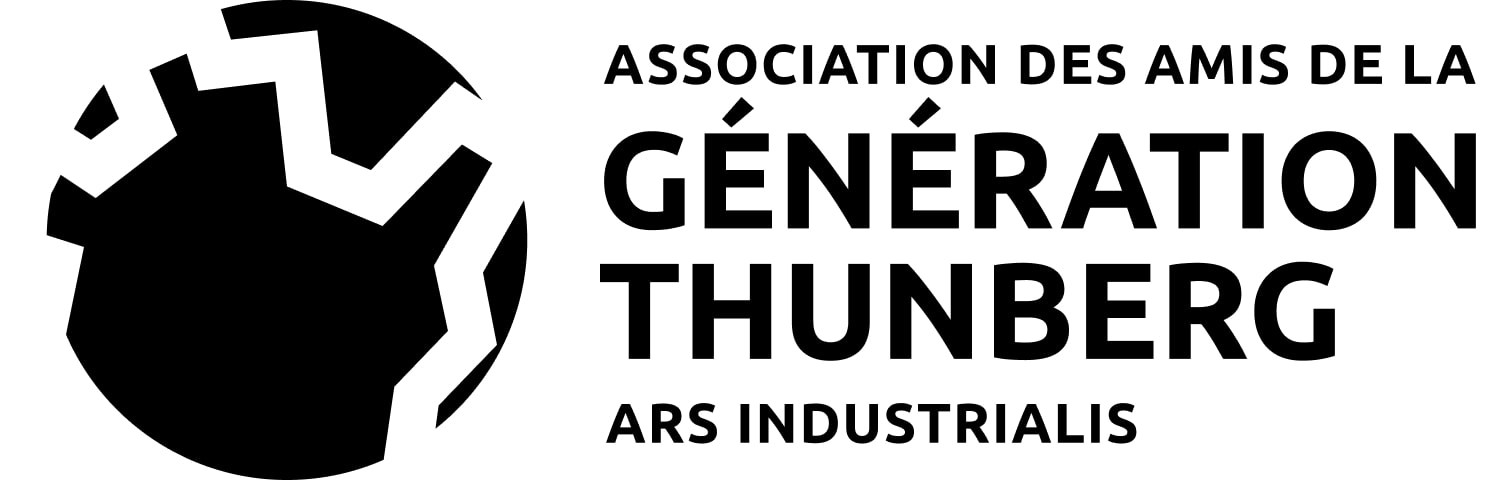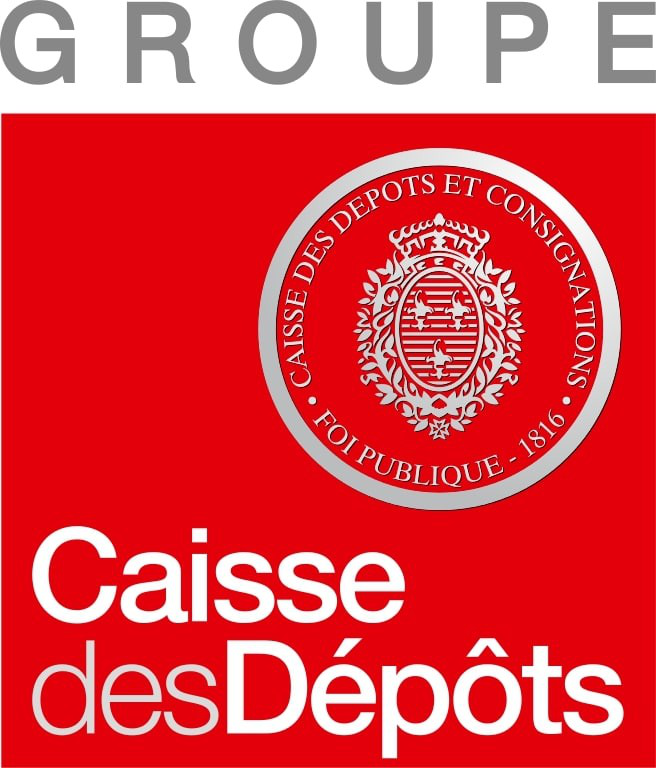Séminaire « Culture et Invention », Ars Industrialis
Publié : Events |
Séance du mardi 11 octobre à 18h en Salle des Actes (45, rue d’Ulm – 75005 Paris)
Jean-Hugues Barthélémy :
« Les anti-substantialismes de Bachelard, Merleau-Ponty et Simondon »
Résumé : La philosophie française du 20e siècle a vu s’épanouir trois véritables filiations, elles-mêmes parfois en relation d’interférence les unes avec les autres :
– la filiation de l’« épistémologie historique », inaugurée par Bachelard à propos de la physique – puis Canguilhem pour la biologie – et remaniée dans sa pratique par Foucault pour penser les sciences humaines ; – la filiation du renouveau de la philosophie de la nature chez Bergson, Teilhard de Chardin et Simondon/Deleuze ;
– la filiation du développement « à la française », c’est-à-dire à tonalité à la fois existentialiste et marxiste chez Sartre et Merleau-Ponty, de la phénoménologie d’origine allemande, vaste courant dont la veine proprement heideggerienne a ensuite suscité en France les œuvres de Derrida et Lévinas.
A elles seules ces trois filiations livrent à peu près tout ce qui s’est fait d’essentiel au sein de la philosophie française du 20e siècle. Or, si la visée commune d’une subversion de l’opposition classique et principielle entre sujet et objet a pu être dégagée par-delà les divergences entre ces trois filiations, on n’a toutefois pas encore montré son lien avec un geste théorique certes plus discret, mais commun lui aussi à Bachelard pour la première filiation, Simondon pour la seconde et Merleau-Ponty pour la troisième : le geste consistant à prendre pour paradigme, à des degrés bien sûr divers, la révolution induite par la physique contemporaine, à des fins de désubstantialisation au sein même de l’entreprise ontologique propre à la philosophie. Afin de développer ici cette thèse exégétique, on considèrera initialement comme acquis : – que la phénoménologie merleau-pontyenne, depuis La structure du comportement jusqu’au Visible et l’invisible en passant par le cours sur La Nature textes où intervient à chaque fois, nous le verrons, la référence à la révolution physique contemporaine -, a toujours été prise dans une ontologie dont le caractère inexorable tenait à l’impossibilité, affirmée dès l’Avant-Propos à la Phénoménologie de la perception, d’une « réduction phénoménologique » complète ; – qu’il y a bien chez Bachelard lui-même une visée anti-substantialiste proprement ontologique et pas seulement épistémologique, même si le «rationalisme régional » de Bachelard ne s’est jamais autorisé la construction ontologique que Simondon, lui, osera dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information.
Qu’il ait fallu un tel geste théorique que nous nommerons « paradigmatisme physique » – au coeur de chacune des trois filiations procède en un sens d’une certaine nécessité : quels que soient les reproches adressés par chacun de ces penseurs au criticisme kantien, la rupture anti-métaphysique introduite par la « révolution copernicienne » de Kant ne peut à leurs yeux qu’être radicalisée plutôt que reniée, et appelle donc elle-même son propre dépassement dans une philosophie qui ne peut qu’être inspirée par la nouvelle révolution physique, par-delà donc les pôles copernicien, galiléen et newtonien d’inspiration qui fonctionnaient chez Kant et qui, de « modernes », sont désormais devenus « classiques ».
C’est en ce point, toutefois, que la question du mouvement distingue la démarche bachelardienne en ce que cette dernière, depuis La valeur inductive de la relativité en 1929, se veut inspirée initialement par la relativité einsteinienne, et dans un second temps seulement par la révolution quantique. Ainsi qu’il apparaîtra en effet, Bachelard, dans Le nouvel esprit scientifique, désubstantialise la « chose » en faisant d’elle une «chose-mouvement », au motif que l’espace et le temps sont devenus un espace-temps. Et même s’il le fait en invoquant déjà la mécanique quantique, la référence à la relativité einsteinienne reste principielle. Ainsi revendiquera-t-il encore dans La philosophie du non, ouvrage pourtant encore davantage consacré à la physique quantique, un « non-kantisme » qui soit un relativisation englobante du kantisme, de même que la relativité einsteinienne avait englobé et relativisé la mécanique newtonienne. Or, chez Bachelard, cette analogie entre progrès de la physique et progrès philosophique n’est pas séparable de l’inspiration méthodologique également puisée dans la Relativité physique. C’est la différence entre la « relativité philosophique » de Bachelard, comme la nomme Vincent Bontems, et une Relativité philosophique plus globale et plus actuelle : dans cette dernière, l’analogie structurale avec la Relativité physique s’accompagne d¹une inspiration méthodologique non pas einsteinienne, mais puisée dans la physique quantique.
Simondon, lui, s’inscrit en un sens dans une filiation épistémologique bachelardienne, mais son « réalisme des relations » anti-substantialiste apparaîtra comme plus fondamentalement lié à la révolution quantique qu’il ne l’était chez Bachelard, pourtant véritable père du réalisme des relations. La différence tiendra en dernière instance à ce que Simondon, par-delà la «non-identité » – encore trop dialectique – de l’ « être » affirmée par Bachelard au terme de La philosophie du non, veut penser une « plus qu’identité » -transductive et non pas dialectique dont seule la dualité quantiqueonde-corpuscule fournit le paradigme. La conséquence en sera que, contrairement à Bachelard, Simondon est pleinement conscient du divorce entre mécanique quantique et relativité einsteinienne, et de la nécessité d’une théorie qui dans son esprit n’est qu’à venir – des « ordres de grandeur » pour les réunifier.
Merleau-Ponty, enfin, se révélera, dans Le visible et l¹invisible davantage encore que dans La structure du comportement ou dans le cours sur La Nature, habité lui aussi par le paradigme quantique et par l’intuition d’une théorie requise des « échelles ». Sans doute sa lecture avant les autres de L’Individu et sa Genèse physico-biologique ouvrage publié grâce à Merleau-Ponty et dédié par Simondon à sa mémoire n’y est-elle pas pour rien. Mais conformément au questionnement phénoménologique dont il hérite et qu’il tente de réconcilier avec l’ontologie -, Merleau-Ponty rapporte prioritairement la nouveauté quantique à l¹interrogation principielle sur le rapport du sujet et de l’objet, dont le partage par Bachelard et Simondon ne laisse pas d’être insuffisamment insistant aux yeux d’un phénoménologue.

 in english
in english en français
en français